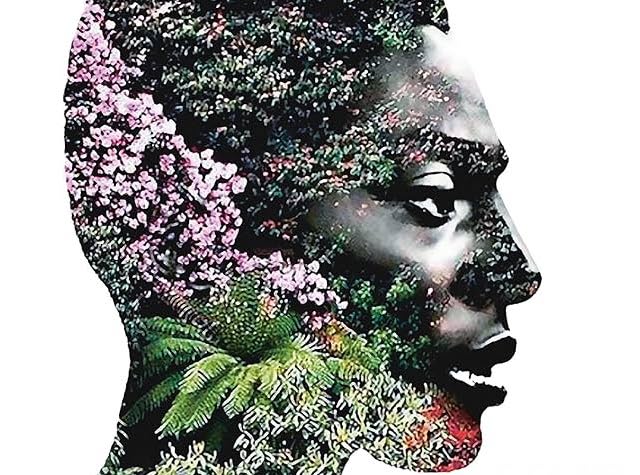Enrique Vila-Matas ne reprend pas Hiroshima mon amour, même après avoir raconté, dans Paris ne finit jamais, son séjour en 1974 dans une chambre de bonne appartenant à Marguerite Duras, qu’il croisait dans l’escalier en espérant recevoir d’elle et de ses conseils sibyllins la clé de l’écriture. Ce dernier livre, intitulé Montevideo, s’ouvre pourtant sur le rappel de ce séjour parisien et du livre qui l’a relaté, mais c’est pour mieux rebaptiser celui-ci Un garage à soi (mélange de Virginia Woolf et de Gertrude Stein – voire de Jean Echenoz mais c’est trop long à expliquer) ; et lui substituer, avant d’y revenir, plusieurs autres lieux et livres. Ce faisant, il déploie une nouvelle série vertigineuse de références propres au commentaire, à la citation et, surtout, à la réécriture.
On reproche souvent à Enrique Vila-Matas d’être un écrivain « au second degré », poursuivant le rêve (lui-même emprunté à Walter Benjamin) du livre cousu de citations, au risque du psittacisme et de l’épigonalité radicale. On le lui reproche ou on l’en loue (comme je l’ai fait moi-même à plusieurs reprises), c’est selon. Mais si Enrique Vila-Matas était bien plutôt devenu, au fil de ses derniers livres, un écrivain « au troisième degré » ? Au sens où le métatexte constant et le régime d’emprunts sur lesquels se fonde son écriture servaient à leur tour de prétexte au déploiement d’un récit secrètement personnel et paradoxalement sincère (à défaut d’être littéral), où se racontaient, par le moyen des chemins détournés et des « sentiers perdus » (Thomas Wolfe), les péripéties d’une vie ?

Car au cœur de ce nouvel exercice virtuose des plagiats et des greffes littéraires (l’auteur doit à la greffe d’un rein d’avoir survécu à la menace qui a tué, il y a vingt ans, son ami Bolaño), se pose une question intime et décisive : comment continuer à écrire ? Ou plutôt : comment continuer d’écrire la difficulté de continuer à écrire ? Comment conjurer le « syndrome Rimbaud » de la renonciation à l’écriture, tout droit hérité du « bestseller » (toutes proportions gardées) désormais ancien (2000), Bartleby et compagnie – joliment rebaptisé ici Vertiges de la suspension pour les besoins de la fiction de soi ? Comment conjurer la hantise du trop fameux « I’d prefer not to » auquel le narrateur-écrivain ne cesse de préférer renoncer ?
Montevideo, « qui était une ville mais aussi un état d’âme, un rythme ancien aux pieds nus », y répond en 4 temps 6 mouvements (plus 5 « catégories » de littérature et une mygale). On restera elliptique à dessein, pour laisser aux lecteur·ice·s le plaisir de la découverte. Disons simplement que les six mouvements passent par Paris, Cascais, Montevideo, Reykjavik, Bogotá (et Saint-Gall) et de nouveau Paris. Et que les quatre temps principaux que dessine cette géographie reposent sur la scansion des références, entre autres, à Wolfe, Tabucchi, Calvino, Valéry, Melville, Sterne et – principalement – Cortázar. Ainsi que sur le récit d’une complicité artistique avec « Madeleine Moore » et ses installations (lesquelles prolongent Kassel invite à la logique et l’expérimentation véritablement menée, à cette occasion, avec Dominique Gonzalez-Foerster).
On entend, dans Montevideo, le rire de Jean-Pierre Léaud dans la chambre contiguë à celle du narrateur dans un hôtel de Cascais. On y voit les écrivains de jadis traverser la mémoire comme autant de baleines blanches. On y balance entre Shandysme ou Valérysme, pour mieux les abandonner à leur tour. Et l’on y suit Cortázar dans le dédale de ses nouvelles ou la marelle de son roman le plus célèbre, Rayuela, pour mieux se trouver soi-même.
Dans cette écriture au troisième degré, l’art de l’anecdote et l’art de la citation s’inspirent l’un de l’autre. La chambre 205 de l’hôtel Cervantes de Montevideo opère le « croisement du réel et du fictif » dans l’expérience renouvelée (et modifiée) de la nouvelle de Cortázar, « Une porte condamnée ». Apparaît, dans la « vraie » vie, une araignée monstrueuse. Peut-être une mygale. Est-on encore chez Cortázar ? Ou bien déjà à Beaubourg, dans l’installation en forme de chambre secrète de Madeleine Moore, qui débouche (c’est mieux que l’avion) sur Bogotá ?
Montevideo n’est donc pas seulement le nom d’une ville : c’est aussi celui de toute une bibliothèque portative, cousue dans la poche secrète d’une vie. C’est une cartographie des déplacements de l’écriture au fil des échecs et des impasses, des deuils et des rêves, des pas de portes dérobées et des voies de passage qui prolongent les errances des romans passés (du Mal de Montano à Mac et son contretemps) et leur exploration de l’abîme. C’est aussi une histoire des pas de côté qui rendent « fluides » et « perméables » vie et littérature (deux valeurs que le narrateur propose d’ajouter aux six des Leçons américaines de Calvino, en précisant bien qu’il n’y a pas d’autofiction car tout livre est une fiction de soi).

Montevideo, c’est une « biographie de mon style », dit l’avatar de l’auteur, ce double transparent jouant au « jeu de Je est un autre ». Double transparent au lecteur, peut-être, mais double qui demeure opaque à soi-même, car toujours placé de l’autre côté de la « porte condamnée » de Montevideo, ou de la « ligne d’ombre » (Conrad) des temps et des romans passés. Il est à la fois l’identité perdue et retrouvée. Il est à la fois le naufragé et son spectateur. Mais en tout cas, de Reykjavik ou Bogotá il peut toujours revenir au Paseo de San Juan de son enfance, la « rue Rimbaud » qui demeure placée, Montevideo ou pas, au centre de la géographie de la vie d’Enrique Vila-Matas et de tous ses doubles.
On pourra donc dire de Montevideo que c’est à la fois un exercice de style et un portrait de soi. Et que c’est un livre sérieux mais qui n’est pas sérieux.
Dans sa réponse au « Questionnaire de Bolaño », Enrique Vila-Matas confiait déjà ceci : « J’essaie de m’amuser en écrivant (ce qui m’est arrivé avec mon dernier livre, Montevideo), et je sais que si j’y parviens – j’y parviens toujours ces derniers temps – je transmettrai sûrement ce côté divertissant à mes lecteurs. » On le vérifiera aisément en allant faire un petit tour à Montevideo.